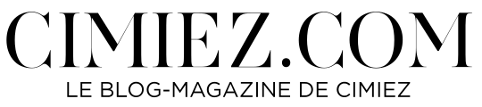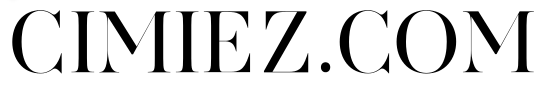À Nice, l’eau ne se contente pas d’être une ressource vitale — elle façonne la ville depuis ses origines. Dès le Ve siècle av. J.-C., les Grecs choisissent de s’installer au pied de la colline du Château, attirés par une source qui coule à flanc de rocher. Cette relation entre la cité et l’eau ne cessera d’évoluer, au rythme des besoins, des techniques et des ambitions humaines.
Les Romains, installés sur la colline de Cimiez, construisent des thermes imposants à Cemenelum, alimentés par des aqueducs venant de Mouraille et Falicon. En l’absence de sources suffisantes sur place, ils inventent un réseau souterrain sophistiqué pour faire circuler l’eau jusqu’à la ville haute.

Au Moyen Âge, les Niçois descendent dans la plaine et perpétuent l’usage des puits privés et publics. L’eau du Paillon est captée et détournée grâce à des digues et des canaux, alimentant moulins et cultures. L’ingéniosité se poursuit à la Renaissance : en 1517, un puits de 72 mètres de profondeur, surnommé « le puits du diable », est creusé pour alimenter la forteresse du Château. Quelques décennies plus tard, un réseau d’adduction souterrain permet d’irriguer les jardins du Palais ducal avec l’eau de la source du Sourgentin.
Au XVIIIème siècle, le canal des moulins traverse la ville, mettant en mouvement les industries naissantes. Des systèmes comme la noria — grande roue hydraulique actionnée par des animaux ou par le courant — témoignent encore aujourd’hui, notamment au mont Vinaigrier, du savoir-faire hydraulique de l’époque.
Mais avec le développement du tourisme au XIXe siècle, Nice fait face à un défi majeur : celui de l’eau courante. Malgré des puits et quelques fontaines, les besoins croissants dépassent les capacités locales. À partir de 1821, la ville investit dans des infrastructures modernes : conduites enterrées, fontaines publiques, captation de sources. De nombreuses fontaines ornent alors les places niçoises, alliant utilité et esthétique, comme la fontaine des Tritons, offerte par le commandeur Arson.
L’élan est collectif : les grands propriétaires fonciers et même les hivernants s’impliquent. La reine Victoria fait don d’une fontaine pour les chevaux peinant à gravir Cimiez ; d’autres offrent des fontaines pour les chiens, les bêtes de somme ou les passants assoiffés.
Face à l’essor fulgurant de la ville — sa population triple entre 1860 et 1914 — Nice réalise un projet d’envergure : la construction du canal de la Vésubie, long de plus de 30 km, qui amène l’eau pure des montagnes jusqu’à la ville. Une infrastructure essentielle, encore aujourd’hui, lors des épisodes de sécheresse estivale.

Nice, ville solaire, est aussi une cité de l’eau — discrète mais omniprésente, façonnant ses paysages, ses usages et son patrimoine. Des aqueducs antiques aux fontaines de la Belle Époque, chaque goutte raconte une page de son histoire.